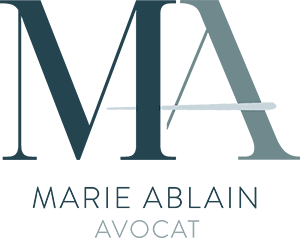ETAT DES LIEUX DE LA JURISPRUDENCE
La notion de préjudice nécessairement subi revient au cœur de l’actualité jurisprudentielle en droit du travail.
Longtemps source d’incertitudes, elle fait aujourd’hui l’objet d’un effort d’objectivation de la part de la Cour de cassation qui lui consacre un podcast très éclairant, exposant la méthodologie élaborée pour apprécier l’existence, ou non, d’un préjudice nécessaire. [1]
Retour sur une évolution récente de la jurisprudence marquée par une influence croissante du droit européen.
🔍 Qu’est-ce que le préjudice nécessairement subi ?
En droit commun de la responsabilité civile, trois conditions doivent être réunies pour obtenir réparation : l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Toutefois, en droit du travail, certaines situations sont considérées comme causant automatiquement un préjudice au salarié, sans qu’il ait besoin d’en apporter la preuve : on parle alors de préjudice nécessairement subi.
Ce mécanisme repose sur l’idée que le seul manquement de l’employeur suffit à caractériser un dommage, ce qui facilite l’indemnisation du salarié et renforce l’effectivité de ses droits.
⚖️ Une évolution jurisprudentielle en deux temps
1. Une jurisprudence en expansion dans les années 90
À partir des années 1990, la Cour de cassation reconnaît un préjudice nécessaire dans de nombreuses hypothèses :
- En cas de violation de règles de procédure liées au licenciement ;
- En cas de défaut de remise par l’employeur de documents de fin de contrat (Soc., 7 déc. 1999, n° 97-43.106) ;
- Lorsqu’une clause de non concurrence était jugée illicite (Soc., 22 mars 2006, n° 04-45.546).
2. Le tournant de 2016 : recentrage sur le droit commun
Par un arrêt du 13 avril 2016, la Chambre sociale de la Cour de cassation a marqué un retour au droit commun en retenant que l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. (Soc., 13 avril 2016, n° 14-28.293)
Dès lors, le salarié doit apporter des éléments de preuve justifiant le préjudice qu’il allègue.
Pour autant, il ne s’agit pas d’un abandon du préjudice nécessaire mais plutôt d’un reflux, la volonté de la Cour de cassation étant d’objectiver le recours à la notion du préjudice nécessaire.
📖 Quand peut-on encore parler de préjudice nécessaire ?
Malgré ce retour au droit commun de la responsabilité civile, deux grandes catégories d’exceptions subsistent.
Elles permettent encore aujourd’hui au salarié d’être indemnisé sans avoir à démontrer son préjudice.
1. Les textes de droit interne
Certaines lois prévoient expressément une indemnité automatique, comme :
- L’indemnité sanctionnant le travail dissimulé prévue à l’article L.8223-1 du Code du travail qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire ;
- L’indemnité de requalification d’un CDD en CDI prévue à l’article L.1245-2 du Code du travail qui ne peut être inférieure à 1 mois de salaire ;
- L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : l’article L.1235-3 du Code du travail prévoit un barème octroyant une indemnité d’un montant minimal au salarié. (Soc., 19 janv. 2022, n° 20-12.420, 20-12.421) ;
C’est le cas également lorsque la reconnaissance du préjudice nécessaire n’est pas explicitement prévue par le texte de droit interne, mais en résulte.
C’est ainsi que la Chambre sociale déduit de la lecture de l’article 9 du code civil que la seule constatation de l’atteinte à la vie privée des salariés leur cause nécessairement un préjudice. (Soc., 12 nov. 2020, n° 19-20.583)
2. Les exceptions tirées des engagement européens
La deuxième série d’exception dégagée par la Cour de cassation s’appuie sur l’obligation faite au juge d’assurer l’effectivité de la norme d’origine européenne.
➡️ Lorsque le texte européen interprété par la CJUE envisage l’existence d’un préjudice nécessaire
La Cour de justice de l’Union européenne a ouvert la voie avec l’affaire Fuß c/ Stadt Halle, en affirmant que le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail (48h) constituait en tant que tel une violation de la directive européenne du 4 novembre 2003 (article 6b) ouvrant droit à réparation, sans preuve du préjudice. (CJUE, n° C-243/09, Fuß c/ Stadt Halle,14 octobre 2010)
Sur cette base, la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 26 janvier 2022 (pourvoi n° 20-21.636) que le seul constat du dépassement ouvrait droit à réparation.
➡️ Lorsque le droit interne poursuit les mêmes objectifs que le droit européen
Même sans décision explicite de la CJUE, la jurisprudence nationale reconnaît un préjudice nécessaire lorsqu’une norme de droit interne sert les mêmes finalités que le droit européen.
Elle a ainsi admis une réparation automatique en cas de :
- Dépassement de la durée maximale de travail quotidien de 10H
👉 Soc., 11 mai 2023, n° 21-22.281, 21-22.912
- Dépassement de la durée maximale de travail des travailleurs de nuit
👉 Soc., 27 septembre 2023, n° 21-24.782
- Non-respect d’un temps minimum de repos entre deux services
👉 Soc., 7 février 2024, n° 21-22.809, 21-22.994
📌 Dans ces arrêts, la Cour rappelle que les normes françaises poursuivent le même objectif que la directive du 4 novembre 2003 à savoir garantir le repos suffisant et la protection de la santé des travailleurs.
➡️ Lorsque le droit commun ne suffit pas à assurer l’effectivité des normes européenne
La CJUE exige des sanctions efficaces, dissuasives et proportionnées (CJCE, 10 avril 1984, von Colson et Kamann, n° C-14/83). Or, le droit commun de la responsabilité civile, qui exige la démonstration d’un préjudice ne le permet pas toujours.
📌 Dans une série d’arrêts du 4 septembre 2024, la Cour de cassation reconnaît un préjudice nécessaire dans les cas suivants :
- Non-respect du temps de pause quotidien
👉 Soc., 4 sept. 2024, n° 23-15.944
- Travail d’une salariée durant son congé de maternité
👉 Soc., 4 sept. 2024, n° 22-16.129
- Travail d’un salarié pendant son arrêt maladie
👉 Soc., 4 sept. 2024, n° 23-15.944
Il s’agissait en effet de sanctionner des manquements de l’employeur à des obligations imposées par différents textes de droits internes qui transposaient des dispositions directes de directives.
📖 Quand la preuve du préjudice redevient-elle indispensable ?
La Cour de cassation ne reconnaît pas l’existence d’un préjudice nécessaire dans plusieurs situations spécifiques. Deux grandes hypothèses se dégagent :
1. Lorsque le droit interne ne transpose pas une directive d’effet direct
Dans ce cas, les règles de droit commun sont jugées suffisantes.
- Suivi médical du travailleur de nuit :
👉 Cass. soc., 11 mars 2025, n° 21-23.557
La Cour admet, à la suite d’une décision de la CJUE du 20 juin 2024 saisie d’une question préjudicielle, que le salarié doit prouver son préjudice, le droit commun étant jugé suffisant pour assurer l’effectivité de la norme relative au suivi médical du travailleur de nuit.
- Retard dans l’organisation de la visite de reprise suite à invalidité / congé maternité :
👉 Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 22-23.648 et n° 22-16.129
La reconnaissance d’un préjudice nécessaire est exclue : le salarié devait justifier concrètement du préjudice lié au défaut d’organisation de ces visites médicales.
2. Lorsque des sanctions alternatives existent
La Cour considère qu’il n’est pas nécessaire de reconnaître un préjudice automatique si d’autres moyens de réparation sont accessibles au salarié.
- Convention de forfait invalide → paiement des heures supplémentaires :
👉 Cass. soc., 11 mars 2025, n° 23-19.669 et n° 24-10.452
L’invalidité ou la nullité d’une convention de forfait jours ouvre droit à une demande salariale directe, sans besoin de présumer un préjudice.
- Violation de l’obligation d’assurer l’effectivité du droit à congés payés → droits reportés ou indemnisés :
👉 Cass. soc., 11 mars 2025, n° 23-16.415
Ici, la Cour rejette l’octroi automatique de dommages et intérêts, estimant que la règle est suffisamment protectrice via le report ou l’indemnisation des congés.
À SUIVRE
L’évolution de la jurisprudence sur cette notion qui dépend étroitement de l’interprétation des textes européens, reste en constante construction. Une veille attentive s’impose pour anticiper les prochaines inflexions.
[1] https://www.courdecassation.fr/publications/la-sociale-le-mag-podcast/ndeg36-avril-2025/ecoutez-la-sociale-le-mag